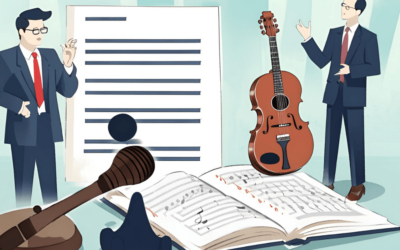La musique d’un artiste camerounais, Snoopy la mélodie, a été en ligne durant plusieurs mois sur plusieurs plateformes de streaming musical telles que Spotify, Deezer, Qobuz, Apple Music, YouTube et TikTok. Or, cette œuvre contient des propos à caractère homophobe. Face à la gravité de tels contenus on se demande s’il est juridiquement possible d’engager la responsabilité de ces plateformes ? Et ce, sans même qu’un signalement préalable ne leur ait été adressé. À travers l’analyse du Digital Services Act (DSA) et de la jurisprudence française et européenne, cet article propose une réponse fondée sur la qualification juridique des plateformes en ligne : sont-elles hébergeurs ou éditeurs de contenu ?

Hébergeur ou éditeur : une distinction structurante en matière de
responsabilité des plateformes
L’hébergeur, un acteur passif bénéficiant d’un régime de responsabilité aménagée
Le règlement (UE) 2022/2065 (DSA) consacre la responsabilité limitée des plateformes : prestataires de services numériques dits hébergeurs, définis à l’article 3 g) iii) comme ceux qui « stockent des informations fournies par un destinataire du service à sa demande ».
Conformément à l’article 6 du DSA, ces plateformes ne sont pas responsables des contenus illicites qu’ils hébergent tant qu’ils :
- N’en ont pas eu effectivement connaissance, ou
- agissent promptement pour retirer le contenu dès qu’ils en ont connaissance.
Cette disposition met en place un régime de responsabilité conditionnée au signalement: en l’absence de notification, l’hébergeur ne peut être tenu responsable. Une fois informé, il doit prendre toutes les mesures pour faire cesser la diffusion du contenu litigieux, sous peine de voir sa responsabilité engagée.
L’éditeur, un acteur actif responsable des contenus diffusés
À l’inverse, une plateforme peut être requalifiée en éditeur lorsqu’elle exerce un rôle actif dans la gestion des contenus. Ce rôle actif, dégagé notamment par la CJUE dans l’affaire Google Adwords ( CJUE, 23 mars 2010 ), se caractérise par :
- Une implication dans la sélection, la présentation ou la modération des contenus,
- Un pouvoir de contrôle ou de connaissance sur les informations diffusées.
Le régime de responsabilité applicable aux plateformes éditrices est classique : elle est responsable des contenus mis en ligne, même sans notification préalable. Puisque c’est l’éditeur qui édite et publie le contenu, il ne peut donc se réfugier derrière une posture passive. Cette qualification s’apprécie au cas par cas en fonction des compétences de la plateforme.
La jurisprudence française récente, notamment les décisions Airbnb (CA Paris, 3 janvier 2023) et Abritel ( TJ Paris, 21 février 2023), montre que cette requalification est possible dès lors que la plateforme impose des règles, encadre les publications, ou interfère dans la relation entre les utilisateurs.
Il s’agit d’une multitude de critères qui permettent de qualifier ces plateformes d’éditeur. Il pourra par exemple s’agir de :
- l’obligation pour les « hôtes » d’adopter certains comportements,
- l’immixtion dans la rédaction des contenus publiés,
- ou encore l’obligation pour les utilisateurs d’échanger uniquement via la plateforme.
L’une de ces plateformes avait par exemple recours à un système de récompense des « hôtes ». Offrant ainsi une meilleure visibilité à leurs annonces.
Ces plateformes ont également un système de sanction des contenus ou des utilisateurs qui violeraient leurs conditions générales. Le fonctionnement spécifique de ces plateformes qui mettent en relation des « hôtes » et des locataires leur a donné le caractère d’éditeur.
Application aux plateformes diffusant la musique litigieuse
L’étude des conditions d’utilisation des principales plateformes diffusant la musique litigieuse apporte des éléments d’analyse utiles. Elle permettrait d’appliquer certains critères déjà retenus pour les plateformes de mise en relation d’hôtes et de locataires.
Spotify : une responsabilité de la plateforme ?
Spotify est la plateforme dont l’implication dans la gestion des contenus semble la plus marquée. L’accès à Spotify for Artists est soumis à la validation d’un distributeur agréé, qui gère les droits des œuvres. Les artistes qui publient du
contenu accordent à Spotify une licence très large. Cette dernière inclue le droit de reproduire, modifier, traduire, diffuser, etc. Les conditions d’utilisation de Spotify interdisent la publication de tout contenu illicite dont l’incitation à la haine. Spotify impose aux artistes de publier leurs contenus en respectant des exigences de qualité et de format. Elle leur permet aussi de fournir des métadonnées pour améliorer la visibilité de leurs contenus.
Spotify propose à ses utilisateurs des recommandations de contenu. Celles-ci sont créées par une équipe éditoriale humaine et par des algorithmes.
L’équipe éditoriale peut créer des playlists personnalisées selon les goûts de chaque auditeur. Elle s’appuie sur l’analyse des données et les tendances culturelles pour choisir les contenus.
En parallèle, l’algorithme génère aussi des recommandations personnalisées. Ces suggestions évoluent en fonction de l’usage que l’auditeur fait de Spotify. Dans Spotify for Artists, plusieurs outils sont disponibles pour les artistes. Ils peuvent ainsi mettre en avant leurs contenus.
Ces outils permettent aussi d’élaborer une stratégie de diffusion pour maximiser les écoutes et optimiser les sorties musicales. Plus d’informations sont accessibles ici. Spotify dispose en outre d’un pouvoir de sanction (suspension ou suppression de contenus) et peut surveiller les contenus.
Ces éléments pourraient traduire une intervention directe dans la hiérarchisation des contenus et la promotion de certains artistes. Le rôle de Spotify ne se limiterait donc pas à l’hébergement, mais pourrait tendre vers une véritable activité
éditoriale.
Dès lors, une action en responsabilité pourrait être envisagée sans signalement préalable, en raison de la perte du statut protecteur d’hébergeur. Ainsi la responsabilité de cette plateforme de musique pourrait se voir engagée pour les contenus où elle aurait eu une action positive.
YouTube et TikTok : des très grandes plateformes au rôle neutre
YouTube et TikTok sont qualifiés de Très grandes plateformes au sens du DSA par la Commission européenne dans deux décisions du 25 avril 2023. Elles permettent aux utilisateurs de publier directement leurs vidéos. Tiktok permet également de
créer du contenu à l’aide de bibliothèques musicales intégrées.
Bien qu’elles disposent de règles communautaires, d’un pouvoir de modération et de certaines fonctionnalités de promotion (exemple : l’onglet “Pour toi” sur TikTok), les critères d’implication semblent moins marqués que pour Spotify. L’utilisateur
garde l’initiative de la création, et la plateforme n’interviendrait pas directement dans la production ou la sélection des contenus.
En l’état des informations disponibles, leur statut d’hébergeur semble subsister, impliquant que leur responsabilité ne pourrait être engagée qu’après signalement.
Deezer, Qobuz et Apple Music : des hébergeurs au rôle neutre
Ces plateformes fonctionnent principalement via des distributeurs de musique pour la publication des musiques. Elles ne semblent pas exercer de rôle actif dans la mise en avant ou la sélection des œuvres. De plus leurs conditions générales n’indiquent pas de pouvoir d’intervention notable dans les contenus. Elles bénéficieraient donc, à ce stade, du régime de l’hébergeur.
Enjeux et perspectives
La diffusion de contenus homophobes sur des plateformes de streaming pose une question délicate d’articulation entre plusieurs enjeux. Il s’agit notamment de concilier la liberté d’expression, le rôle technique des plateformes et la protection des publics. Le régime du DSA a clarifié les obligations des hébergeurs et des éditeurs. Toutefois, il subsiste une zone grise d’interprétation. Le critère central pour trancher reste celui du rôle actif.
Tant que la plateforme agit comme un simple hébergeur, sa responsabilité dépend d’une alerte préalable. En revanche, si elle intervient dans la sélection, la hiérarchisation ou la monétisation des contenus, elle change de statut. Elle peut alors devenir un acteur éditorial à part entière. Elle devient responsable des contenus diffusés, même sans signalement préalable.
Aujourd’hui, les discours de haine en ligne se propagent souvent via les algorithmes et la viralité. Dans ce contexte, la responsabilité proactive des plateformes devient un enjeu crucial.
Spotify semble être la plateforme dont le fonctionnement se rapproche le plus des critères retenus par la jurisprudence. Ces critères ont permis de qualifier Abritel et Airbnb d’éditeur vis-à-vis des contenus publiés. Cependant, les plateformes de streaming musical ne fonctionnent pas exactement comme celles dédiées à la mise en relation. Ces dernières ont pour objet de mettre en relation leurs utilisateurs. Cela induit ainsi une implication dans les contenus et dans les relations entre les utilisateurs. Cette implication n’est pas présente de la même manière dans les plateformes de streaming. Toutefois, Spotify interfère dans les contenus postés. Elle met à disposition des outils permettant aux artistes de promouvoir leurs contenus. Elle dispose aussi d’un pouvoir de surveillance et de sanction vis-à-vis des contenus. Ainsi, au regard de la qualification retenue pour Airbnb et Abritel, la plateforme pourrait être considérée comme un éditeur. Cette qualification pourrait concerner certains contenus.
***
Pour toute demande de conseil juridique, n’hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez dès à présent demander un devis gratuit ici.