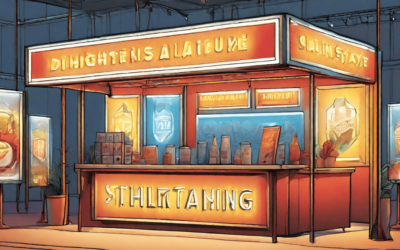Le Tribunal judiciaire de Marseille vient de reconnaître, pour la première fois, la validité de la blockchain comme preuve de la titularité de droits d’auteur sur des vêtements. Cette décision inédite souligne l’importance grandissante de cette technologie dans la protection et l’horodatage des créations. Comment fonctionne la blockchain ? Pourquoi constitue-t-elle un atout majeur pour prouver la paternité d’une œuvre ? Et quelles sont les conséquences pratiques pour les créateurs et les marques ?

1. De l’atelier de création à la contrefaçon : l’affaire AZ Factory
Lorsque l’on parle de contrefaçon, on imagine souvent des marchés exotiques où se vendent des imitations de grandes marques de luxe, ou encore des copies numériques piratées sur internet. Pourtant, l’histoire récente nous montre que même des créateurs de prêt-à-porter se retrouvent exposés à des reproductions frauduleuses de leurs modèles originaux. C’est précisément ce qui est arrivé à la société AZ Factory.
L’affaire en quelques mots
AZ Factory, une maison de mode réputée pour ses pièces originales et créatives, commercialise notamment des pyjamas baptisés Love With Alber et Hearts With Alber. Conçus à partir des croquis d’Alber Elbaz, créateur renommé, ces vêtements se distinguent par l’originalité de leurs choix esthétiques : coupe, motifs de cœurs, jeux de couleurs… Or, alors que la marque proposait ses pièces sur le marché, elle a découvert que des contrefaçons – d’une qualité bien inférieure – étaient vendues sous le manteau, reprenant en tous points l’apparence de ses pyjamas.
Le recours à la blockchain
Face à cette situation, AZ Factory avait pris les devants en ancrant ses croquis et images des vêtements dans la blockchain, via la solution « Blockchainyour IP ». Cet ancrage permet de dater, de manière infalsifiable, la conception d’une œuvre ou d’un dessin. Lorsqu’un conflit surgit concernant la paternité d’une création, la blockchain offre ainsi une preuve solide et presque impossible à remettre en cause.
Dans le cadre de la procédure judiciaire, deux constats d’horodatage blockchain (en date des 5 mai 2021 et 15 septembre 2021) ont été produits à l’appui de la demande d’AZ Factory. Grâce à ces documents, la marque a pu attester que les modèles originaux étaient bel et bien issus de son travail, et qu’elle en détenait les droits patrimoniaux. Résultat : par un jugement du 20 mars 2025, le Tribunal judiciaire de Marseille a non seulement reconnu l’originalité de ces vêtements, mais aussi la validité de la blockchain comme mode de preuve de la titularité des droits d’auteur.
Cette décision est une étape importante pour tous les créateurs : elle assoit la réputation de la blockchain comme outil fiable d’horodatage et de protection, tout en démontrant sa pertinence dans le cadre d’un litige relatif à des droits d’auteur.
2. Comprendre la blockchain : une clé pour protéger ses créations
Si le terme « blockchain » vous évoque d’abord les cryptomonnaies comme le Bitcoin, sachez que cette technologie est bien plus vaste. De plus en plus, la blockchain s’impose dans différents domaines, et notamment celui de la propriété intellectuelle. Mais comment fonctionne-t-elle concrètement, et pourquoi est-elle un outil particulièrement intéressant pour prouver la paternité et la date de création d’une œuvre ?
Les fondements de la blockchain
La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’informations qui fonctionne sans organe central de contrôle. Ses caractéristiques principales sont :
- Transparence : toutes les transactions ou informations enregistrées sur la blockchain sont visibles par l’ensemble des participants du réseau.
- Sécurité : une fois qu’une information est inscrite, elle ne peut plus être modifiée ni effacée. On parle de registre « infalsifiable ».
- Décentralisation : la validation des informations ne dépend pas d’une autorité centrale, mais d’un ensemble d’ordinateurs (les « nœuds ») qui doivent parvenir à un consensus.
Concrètement, la blockchain enregistre chaque nouvelle donnée dans un « bloc » qui vient s’ajouter à la chaîne de blocs existante. Pour valider ce nouveau bloc, les différents nœuds du réseau utilisent des protocoles cryptographiques complexes, rendant la fraude quasiment impossible.
Un ancrage horodaté pour vos créations
En matière de création artistique ou de design, la blockchain offre une fonctionnalité essentielle : l’horodatage. Lorsqu’un créateur dépose un document (croquis, photo, description, etc.) sur la blockchain via un service dédié, ce dépôt se voit attribuer une date précise, et cette date ne pourra plus être contestée. On parle alors d’« ancrage ».
Cette technique présente plusieurs avantages :
- La fiabilité de la preuve : la nature même de la blockchain rend cette date très difficile à contester, puisque le réseau décentralisé authentifie l’enregistrement.
- La simplicité d’accès : contrairement à certaines formalités administratives pouvant exiger un déplacement chez un notaire ou une enveloppe Soleau, l’ancrage blockchain peut s’effectuer en ligne, à tout moment.
- La valeur juridique grandissante : comme l’illustre le cas d’AZ Factory, les juridictions françaises commencent à admettre la blockchain comme mode de preuve recevable.
Grâce à la reconnaissance de cette technologie par les tribunaux, prouver la paternité d’une œuvre (dessin, modèle, partition, texte, etc.) devient un processus à la fois rapide et solide.
3. Les retombées concrètes pour les créateurs et les marques
La décision du Tribunal judiciaire de Marseille en faveur d’AZ Factory interpelle tous ceux qui souhaitent sécuriser leurs créations. Comment cette reconnaissance juridique de la blockchain se traduit-elle dans la pratique ? Quels sont les atouts et limites à connaître avant de recourir à ce système ?
Un moyen de preuve additionnel et efficace
Jusqu’à présent, la preuve de la titularité d’un droit d’auteur reposait souvent sur :
- le dépôt légal auprès d’organismes spécialisés,
- l’utilisation de l’enveloppe Soleau (proposée par l’INPI),
- l’horodatage notarié,
- ou encore le recours à un huissier.
S’il reste tout à fait possible de passer par ces méthodes traditionnelles, elles peuvent se révéler coûteuses, contraignantes ou difficiles à obtenir dans l’urgence. La blockchain ajoute donc un nouvel outil à la disposition des créateurs, offrant :
- Une preuve techniquement difficile à contester : la sécurisation cryptographique et la décentralisation garantissent que la date et la forme du dépôt n’ont pas pu être modifiées a posteriori.
- Un process simplifié : la plupart des plateformes proposant des services d’« ancrage » permettent de déposer rapidement ses créations, moyennant des frais généralement raisonnables.
En cas de litige, la combinaison d’une preuve « blockchain » et d’autres éléments (contrats, témoignages, publications antérieures) renforce le dossier. Il est donc pertinent de voir dans la blockchain une solution complémentaire, qui n’exclut pas les méthodes plus classiques, mais qui peut faire la différence en situation contentieuse.
L’exemple d’AZ Factory : une publicité précieuse pour la blockchain
Dans l’affaire AZ Factory, le Tribunal judiciaire de Marseille n’a pas seulement reconnu l’originalité des pyjamas litigieux : il a aussi affirmé que la preuve de la titularité des droits d’auteur sur ces modèles était établie par l’horodatage blockchain réalisé via la solution Blockchainyour IP. Cette validation judiciaire est cruciale pour l’avenir de la blockchain dans le domaine de la propriété intellectuelle.
Elle confirme ce que de nombreux spécialistes affirmaient déjà : l’horodatage blockchain est un outil fiable, voire incontournable, à mesure que se multiplient les échanges de données numériques et les créations dématérialisées. Cette technologie s’ajoute désormais à la « boîte à outils » juridique de tout créateur ou marque souhaitant défendre ses droits.
Des limites à ne pas négliger
Toutefois, il est important de souligner que la blockchain, bien qu’extrêmement solide en tant que preuve de date et de contenu, n’apporte pas la preuve de l’originalité d’une création. L’originalité demeure une notion juridique, qui suppose que l’œuvre porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et résulte de choix libres et créatifs.
De même, la blockchain ne prouve pas à elle seule qui est l’auteur « moral » de l’œuvre. Elle atteste que tel document (croquis, fichier numérique) existait à telle date, et qu’il a été enregistré par tel titulaire ou sous tel nom. Pour un créateur, il reste donc important de conserver tout autre élément de preuve permettant de mettre en relation son identité et la création litigieuse (courriels, correspondances, témoignages, contrats, etc.).
En somme, la blockchain renforce la sécurité juridique, mais ne dispensera pas d’effectuer les autres vérifications habituelles pour établir la paternité ou l’originalité d’une œuvre.
4. Les perspectives d’avenir : vers une généralisation de la blockchain en propriété intellectuelle ?
Le jugement de Marseille, s’il est historique, n’est pas le premier jalon de la reconnaissance de la blockchain dans le paysage juridique français et international. D’autres décisions sont venues valider cette technologie comme mode de preuve, et l’on peut s’attendre à ce que son usage se généralise dans les années à venir, que ce soit pour le droit d’auteur, les marques ou d’autres domaines de la propriété intellectuelle.
L’évolution de la jurisprudence
Plusieurs juridictions européennes ont déjà considéré la blockchain comme un élément de preuve recevable, notamment en matière de contrefaçon. En France, la loi Pacte de 2019 évoquait déjà la blockchain (ou « dispositif d’enregistrement électronique partagé ») pour des usages financiers, témoignant de l’intérêt grandissant des pouvoirs publics pour ce registre décentralisé.
Ce mouvement devrait s’accélérer à mesure que la technologie se démocratise et devient plus familière des justiciables, des avocats et des magistrats. Les créateurs et les entreprises vont certainement se tourner de plus en plus vers ces solutions pour sécuriser leurs droits et éviter les litiges.
L’intérêt pour la gestion et la traçabilité des droits
Au-delà de l’horodatage, la blockchain ouvre la porte à un suivi en temps réel de la chaîne de titres et de licences. En effet, la notion de « smart contract » (contrat intelligent) permettrait, à terme, de gérer automatiquement les redevances liées à l’exploitation d’une création.
Concrètement, un musicien pourrait déposer ses morceaux sur une plateforme blockchain et encaisser automatiquement des droits d’auteur chaque fois que sa musique serait utilisée ou diffusée. De même, une marque de vêtements, comme AZ Factory, pourrait tracer plus facilement son stock et prouver que certains produits sont bien authentiques, en leur associant un NFT (jeton non fongible) dédié.
Cette traçabilité accrue devrait contribuer à lutter contre la contrefaçon, qui touche autant les industries du luxe que les produits de consommation courante. Pour les consommateurs, ce serait la garantie d’acheter un produit validé par le créateur ou la marque, et pour les entreprises, la certitude de mieux contrôler leurs canaux de distribution.
Les défis techniques et juridiques
Malgré ces perspectives alléchantes, la blockchain doit encore surmonter plusieurs obstacles pour s’imposer comme la référence en propriété intellectuelle :
- La complexité technique : bien que les plateformes proposent des interfaces simplifiées, la technologie sous-jacente (cryptographie, preuve de travail ou preuve d’enjeu, etc.) reste difficile à appréhender pour un public non initié.
- Le coût énergétique : le fonctionnement de certaines blockchains peut se révéler énergivore, ce qui soulève des questions éthiques et environnementales.
- La conformité juridique : la blockchain étant par nature décentralisée, il faut déterminer quels tribunaux seront compétents, et comment respecter les réglementations nationales (en matière de protection des données, par exemple).
Malgré ces défis, la décision du Tribunal de Marseille montre que le droit a vocation à s’adapter rapidement aux évolutions technologiques. Les professionnels du secteur – avocats, juristes, experts en sécurité informatique – travaillent déjà à trouver des solutions pour lever les freins et clarifier le cadre juridique.
***
Pour toute demande de conseil juridique, n’hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez dès à présent demander un devis gratuit ici.